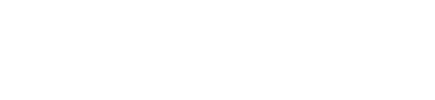Curiosités :
On admirera avec intérêt la petite bastide de Montjoie-en-Couserans fondée en 1256 par un accord de paréage entre Alphonse de Poitiers, comte de Poitiers et de Toulouse, et l'évêque du Couserans. Son église  a été construite au XIIe siècle, puis remaniée aux XIVe et XVIe siècles. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ce qui fait la beauté et l'originalité de cette église est sa façade fortifiée. Il s'agit d'un mur clocher soutenu de chaque côté par une tour octogonale. L'intérieur de l'édifice cache deux trésors : une Vierge à l'enfant derrière le maître-autel et, au dessus du portail, un superbe Christ en bois qui fera votre admiration ... Au sein de la bastide on recherchera avec intérêt l'ancienne porte ogivale
a été construite au XIIe siècle, puis remaniée aux XIVe et XVIe siècles. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ce qui fait la beauté et l'originalité de cette église est sa façade fortifiée. Il s'agit d'un mur clocher soutenu de chaque côté par une tour octogonale. L'intérieur de l'édifice cache deux trésors : une Vierge à l'enfant derrière le maître-autel et, au dessus du portail, un superbe Christ en bois qui fera votre admiration ... Au sein de la bastide on recherchera avec intérêt l'ancienne porte ogivale de la cité, proche de l'église et élément majeur de la fortification dont elle fut l'objet.
de la cité, proche de l'église et élément majeur de la fortification dont elle fut l'objet.
La découverte de Saint Lizier, capitale religieuse du Couserans et évêché du VIe siècle à la Révolution nanti de son passé jacquaire, est un ravissement, un lieu majeur sur notre chemin du piémont pyrénéen. Son église fut commencée au XIIe siècle. Des pierres de construction venant d'anciens bâtiments romains ont servi à sa construction. Au XIVe siècle, la nef autrefois couverte d'une simple charpente a été voûtée d'ogives et divisée en trois travées.On pourra voir le portail à voussures et le clocher octogonal de style toulousain mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur : une restauration récente a permis de découvrir de très belles fresques romanes dans l'abside.Au centre de cette dernière un Christ en majesté entouré des symboles des Évangélistes nous regarde, plein de bonté, depuis plus de 800 ans.
fut commencée au XIIe siècle. Des pierres de construction venant d'anciens bâtiments romains ont servi à sa construction. Au XIVe siècle, la nef autrefois couverte d'une simple charpente a été voûtée d'ogives et divisée en trois travées.On pourra voir le portail à voussures et le clocher octogonal de style toulousain mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur : une restauration récente a permis de découvrir de très belles fresques romanes dans l'abside.Au centre de cette dernière un Christ en majesté entouré des symboles des Évangélistes nous regarde, plein de bonté, depuis plus de 800 ans.
Il faudra voir aussi absolument le cloître et le trésor : ce magnifique ensemble a été sculpté à deux époques différentes. Les chapiteaux de nord et de l'est datent de 1117-1130 et ceux des galeries opposées sont plus tardives (1150-1180). La galerie en bois qui surmonte le cloître a été ajoutée au XVIe siècle. Du cloître on pourra visiter l'ancienne sacristie où se trouve le trésor de la cathédrale. On découvrira le buste reliquaire de Saint Lizier, diverses pièces liturgiques anciennes et quelques curiosités comme cette "verge de bedeau" qui s'avère être un fanon de baleine!
et le trésor : ce magnifique ensemble a été sculpté à deux époques différentes. Les chapiteaux de nord et de l'est datent de 1117-1130 et ceux des galeries opposées sont plus tardives (1150-1180). La galerie en bois qui surmonte le cloître a été ajoutée au XVIe siècle. Du cloître on pourra visiter l'ancienne sacristie où se trouve le trésor de la cathédrale. On découvrira le buste reliquaire de Saint Lizier, diverses pièces liturgiques anciennes et quelques curiosités comme cette "verge de bedeau" qui s'avère être un fanon de baleine!
On ne saurait manquer d'apprécier aussi la cité épiscopale située à l'intérieur des remparts qui couronnent la villa haute. Le palais des Évêques , construit en 1660,devenu Hôtel-Dieu aux XVIIIe et XIXe siècles, abrite le musée de l'Ariège. on y découvrira, entre autres, une ancienne pharmacie (bocaux,faïences,bouteilles d'époque et ouvrages médicaux). Notre Dame de la Sède
, construit en 1660,devenu Hôtel-Dieu aux XVIIIe et XIXe siècles, abrite le musée de l'Ariège. on y découvrira, entre autres, une ancienne pharmacie (bocaux,faïences,bouteilles d'époque et ouvrages médicaux). Notre Dame de la Sède (surnommée "La Chapelle Sixtine ariégoise") est un édifice plus modeste que l'église de la ville basse, ses parties les plus anciennes datent du Xe siècle, son clocher massif est une ancienne tour romaine et l'on retrouve en réemploi des fragments de la frise déjà utilisée sur l'abside de Saint Lizier. Le cloître a disparu, mais la salle capitulaire
(surnommée "La Chapelle Sixtine ariégoise") est un édifice plus modeste que l'église de la ville basse, ses parties les plus anciennes datent du Xe siècle, son clocher massif est une ancienne tour romaine et l'on retrouve en réemploi des fragments de la frise déjà utilisée sur l'abside de Saint Lizier. Le cloître a disparu, mais la salle capitulaire a été préservée avec ses croisées d'ogives en briques et ses chapiteaux magnifiquement sculptés.
a été préservée avec ses croisées d'ogives en briques et ses chapiteaux magnifiquement sculptés.
L'évêque de Saint Lizier, Monseigneur Jean d'Aule, commanda au XVe siècle une série de fresques illustrant la vie de Saint Jacques pour orner les murs de N.D de la Sède. Ces peintures représentent le corps de Saint Jacques dans la barque miraculeuse et la scène du pendu-dépendu.
Sur une maison de Saint Lizier, place des Étendes, une pierre sculptée d'un bourdon et d'une coquille indique qu'Antoine Lassalle est revenu de Compostelle en ... 1655!
Enfin, si vous avez encore quelque temps après ces belles découvertes, n'oubliez pas d'aller admirer ces superbes vestiges que sont aussi les remparts gallo-romains 
On ne peut passer sous silence que Saint Lizier fut le siège d'une confrérie Saint Jacques ... A droite du portail de l'église on pourra voir une petite porte ornée de coquilles : elle ouvrait sur une salle d'accueil réservée aux pèlerins et aux membres de cette confrérie fondée en 1533.On a retrouvé la liste des confrères qui ont effectué le pèlerinage isolément ou par petits groupes, à pied ou à cheval. Les anciens pèlerins avaient droit de porter le bourdon et le chapeau lors des processions et ces insignes jacquaires étaient déposés sur leur cercueil.












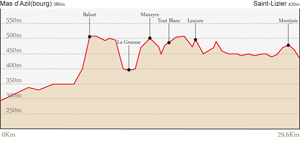
 a été construite au XIIe siècle, puis remaniée aux XIVe et XVIe siècles. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ce qui fait la beauté et l'originalité de cette église est sa façade fortifiée. Il s'agit d'un mur clocher soutenu de chaque côté par une tour octogonale. L'intérieur de l'édifice cache deux trésors : une Vierge à l'enfant derrière le maître-autel et, au dessus du portail, un superbe Christ en bois qui fera votre admiration ... Au sein de la bastide on recherchera avec intérêt l'ancienne porte ogivale
a été construite au XIIe siècle, puis remaniée aux XIVe et XVIe siècles. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ce qui fait la beauté et l'originalité de cette église est sa façade fortifiée. Il s'agit d'un mur clocher soutenu de chaque côté par une tour octogonale. L'intérieur de l'édifice cache deux trésors : une Vierge à l'enfant derrière le maître-autel et, au dessus du portail, un superbe Christ en bois qui fera votre admiration ... Au sein de la bastide on recherchera avec intérêt l'ancienne porte ogivale